L’âge sombre
La doctrine
hindoue enseigne que la durée d’un cycle humain, auquel elle donne le nom de
Manvantara, se divise en quatre âges, qui marquent autant de phases d’un
obscurcissement graduel de la spiritualité primordiale ; ce sont ces mêmes
périodes que les traditions de l’antiquité occidentale, de leur côté,
désignaient comme les âges d’or, d’argent, d’airain et de fer.
Nous sommes
présentement dans le quatrième âge, le Kali-Yuga ou « âge sombre », et nous y
sommes, dit-on, depuis déjà plus de six mille ans, c’est-à-dire depuis une
époque bien antérieure à toutes celles qui sont connues de l’histoire «
classique ».
Depuis lors,
les vérités qui étaient autrefois accessibles à tous les hommes sont devenues
de plus en plus cachées et difficiles à atteindre ; ceux qui les possèdent sont
de moins en moins nombreux, et, si le trésor de la sagesse « non-humaine »,
antérieure à tous les âges, ne peut jamais se perdre, il s’enveloppe de voiles
de plus en plus impénétrables, qui le dissimulent aux regards et sous lesquels
il est extrêmement difficile de le découvrir.
C’est
pourquoi il est partout question, sous des symboles divers, de quelque chose
qui a été perdu, en apparence tout au moins et par rapport au monde extérieur,
et que doivent retrouver ceux qui aspirent à la véritable connaissance ; mais
il est dit aussi que ce qui est ainsi caché redeviendra visible à la fin de ce
cycle, qui sera en même temps, en vertu de la continuité qui relie toutes
choses entre elles, le commencement d’un cycle nouveau.
Mais,
demandera-t-on sans doute, pourquoi le développement cyclique doit-il s’accomplir
ainsi dans un sens descendant, en allant du supérieur à l’inférieur, ce qui,
comme on le remarquera sans peine, est la négation même de l’idée de « progrès
» telle que les modernes l’entendent ?
C’est que le
développement de toute manifestation implique nécessairement un éloignement de
plus en plus grand du principe dont elle procède ; partant du point le plus
haut, elle tend forcément vers le bas, et, comme les corps pesants, elle y tend
avec une vitesse sans cesse croissante, jusqu’à ce qu’elle rencontre enfin un
point d’arrêt. Cette chute pourrait être caractérisée comme une matérialisation
progressive, car l’expression du principe est pure spiritualité ; nous disons
l’expression, et non le principe même, car celui-ci ne peut être désigné par
aucun des termes qui semblent indiquer une opposition quelconque, étant au delà
de toutes les oppositions.
D’ailleurs,
des mots comme ceux d’« esprit » et de « matière », que nous empruntons ici
pour plus de commodité au langage occidental, n’ont guère pour nous qu’une
valeur symbolique ; ils ne peuvent, en tout cas, convenir vraiment à ce dont il
s’agit qu’à la condition d’en écarter les interprétations spéciales qu’en donne
la philosophie moderne, dont « spiritualisme » et « matérialisme » ne sont, à
nos yeux, que deux formes complémentaires qui s’impliquent l’une l’autre et qui
sont pareillement négligeables pour qui veut s’élever au-dessus de ces points
de vue contingents.
Mais
d’ailleurs ce n’est pas de métaphysique pure que nous nous proposons de traiter
ici, et c’est pourquoi, sans jamais perdre de vue les principes essentiels,
nous pouvons, tout en prenant les précautions indispensables pour éviter toute
équivoque, nous permettre l’usage de termes qui, bien qu’inadéquats, paraissent
susceptibles de rendre les choses plus facilement compréhensibles, dans la
mesure où cela peut se faire sans toutefois les dénaturer.
Ce que nous
venons de dire du développement de la manifestation présente une vue qui, pour
être exacte dans l’ensemble, est cependant trop simplifiée et schématique, en
ce qu’elle peut faire penser que ce développement s’effectue en ligne droite,
selon un sens unique et sans oscillations d’aucune sorte ; la réalité est bien
autrement complexe. En effet, il y a lieu d’envisager en toutes choses, comme
nous l’indiquions déjà précédemment, deux tendances opposées, l’une descendante
et l’autre ascendante, ou, si l’on veut se servir d’un autre mode de
représentation, l’une centrifuge et l’autre centripète ; et de la prédominance
de l’une ou de l’autre procèdent deux phases complémentaires de la
manifestation, l’une d’éloignement du principe, l’autre de retour vers le
principe, qui sont souvent comparées symboliquement aux mouvements du cœur ou
aux deux phases de la respiration. Bien que ces deux phases soient d’ordinaire
décrites comme successives, il faut concevoir que, en réalité, les deux
tendances auxquelles elles correspondent agissent toujours simultanément,
quoique dans des proportions diverses ; et il arrive parfois, à certains
moments critiques où la tendance descendante semble sur le point de l’emporter
définitivement dans la marche générale du monde, qu’une action spéciale
intervient pour renforcer la tendance contraire, de façon à rétablir un certain
équilibre au moins relatif, tel que peuvent le comporter les conditions du
moment, et à opérer ainsi un redressement partiel, par lequel le mouvement de
chute peut sembler arrêté ou neutralisé temporairement (1).
Il est
facile de comprendre que ces données traditionnelles, dont nous devons nous
borner ici à esquisser un aperçu très sommaire, rendent possibles des
conceptions bien différentes de tous les essais de « philosophie de l’histoire
» auxquels se livrent les modernes, et bien autrement vastes et profondes. Mais
nous ne songeons point, pour le moment, à remonter aux origines du cycle présent,
ni même plus simplement aux débuts du Kali-Yuga ; nos intentions ne se
rapportent, d’une façon directe tout au moins, qu’à un domaine beaucoup plus
limité, aux dernières phases de ce même Kali-Yuga. On peut en effet, à
l’intérieur de chacune des grandes périodes dont nous avons parlé, distinguer
encore différentes phases secondaires, qui en constituent autant de
subdivisions ; et, chaque partie étant en quelque façon analogue au tout, ces
subdivisions reproduisent pour ainsi dire, sur une échelle plus réduite, la
marche générale du grand cycle dans lequel elles s’intègrent ; mais, là encore,
une recherche complète des modalités d’application de cette loi aux divers cas
particuliers nous entraînerait bien au delà du cadre que nous nous sommes tracé
pour cette étude.
1 Ceci se
rapporte à la fonction de « conservation divine », qui, dans la tradition hindoue,
est représentée par Vishnu, et plus particulièrement à la doctrine des Avatâras
ou « descentes » du principe divin dans le monde manifesté, que nous ne pouvons
naturellement songer à développer ici.
Nous
mentionnerons seulement, pour terminer ces considérations préliminaires,
quelques-unes des dernières époques particulièrement critiques qu’a traversées
l’humanité, celles qui rentrent dans la période que l’on a coutume d’appeler «
historique », parce qu’elle est effectivement la seule qui soit vraiment
accessible à l’histoire ordinaire ou « profane » ; et cela nous conduira tout
naturellement à ce qui doit faire l’objet propre de notre étude, puisque la
dernière de ces époques critiques n’est autre que celle qui constitue ce qu’on
nomme les temps modernes.
Il est un fait assez étrange, qu’on semble n’avoir jamais
remarqué comme il mérite de l’être : c’est que la période proprement «
historique », au sens que nous venons d’indiquer, remonte exactement au VIe
siècle avant l’ère chrétienne, comme s’il y avait là, dans le temps, une
barrière qu’il n’est pas possible de franchir à l’aide des moyens
d’investigation dont disposent les chercheurs ordinaires.
À partir de cette époque, en effet, on possède partout une
chronologie assez précise et bien établie ; pour tout ce qui est antérieur, au
contraire, on n’obtient en général qu’une très vague approximation, et les
dates proposées pour les mêmes événements varient souvent de plusieurs siècles.
Même pour les pays où l’on a plus que de simples vestiges épars, comme l’Égypte
par exemple, cela est très frappant ; et ce qui est peut-être plus étonnant
encore, c’est que, dans un cas exceptionnel et privilégié comme celui de la
Chine, qui possède, pour des époques bien plus éloignées, des annales datées au
moyen d’observations astronomiques qui ne devraient laisser de place à aucun
doute, les modernes n’en qualifient pas moins ces époques de « légendaires »,
comme s’il y avait là un domaine où ils ne se reconnaissent le droit à aucune
certitude et où ils s’interdisent eux-mêmes d’en obtenir.
L’antiquité
dite « classique » n’est donc, à vrai dire, qu’une antiquité toute relative, et
même beaucoup plus proche des temps modernes que de la véritable antiquité,
puisqu’elle ne remonte même pas à la moitié du Kali-Yuga, dont la durée n’est
elle-même, suivant la doctrine hindoue, que la dixième partie de celle du
Manvantara ; et l’on pourra suffisamment juger par là jusqu’à quel point les
modernes ont raison d’être fiers de l’étendue de leurs connaissances
historiques !
Tout cela,
répondraient-ils sans doute encore pour se justifier, ce ne sont que des
périodes « légendaires », et c’est pourquoi ils estiment n’avoir pas à en tenir
compte ; mais cette réponse n’est précisément que l’aveu de leur ignorance, et
d’une incompréhension qui peut seule expliquer leur dédain de la tradition ;
l’esprit spécifiquement moderne, ce n’est en effet, comme nous le montrerons
plus loin, rien d’autre que l’esprit antitraditionnel.
Au VIe
siècle avant l’ère chrétienne, il se produisit, quelle qu’en ait été la cause,
des changements considérables chez presque tous les peuples ; ces changements
présentèrent d’ailleurs des caractères différents suivant les pays. Dans
certains cas, ce fut une réadaptation de la tradition à des conditions autres
que celles qui avaient existé antérieurement, réadaptation qui s’accomplit en
un sens rigoureusement orthodoxe ; c’est ce qui eut lieu notamment en Chine, où
la doctrine, primitivement constituée en un ensemble unique, fut alors divisée
en deux parties nettement distinctes : le Taoïsme, réservé à une élite, et
comprenant la métaphysique pure et les sciences traditionnelles d’ordre
proprement spéculatif ; le Confucianisme, commun à tous sans distinction, et
ayant pour domaine les applications pratiques et principalement sociales.
Chez les
Perses, il semble qu’il y ait eu également une réadaptation du Mazdéisme, car
cette époque fut celle du dernier Zoroastre (2).
Dans l’Inde,
on vit naître alors le Bouddhisme, qui, quel qu’ait été d’ailleurs son
caractère originel (3), devait aboutir, au contraire, tout au moins dans
certaines de ses branches, à une révolte contre l’esprit traditionnel, allant
jusqu’à la négation de toute autorité, jusqu’à une véritable anarchie, au sens
étymologique d’« absence de principe », dans l’ordre intellectuel et dans
l’ordre social.
Ce qui est
assez curieux, c’est qu’on ne trouve, dans l’Inde, aucun monument remontant au
delà de cette époque, et les orientalistes, qui veulent tout faire commencer au
Bouddhisme dont ils exagèrent singulièrement l’importance, ont essayé de tirer
parti de cette constatation en faveur de leur thèse ; l’explication du fait est
cependant bien simple : c’est que toutes les constructions antérieures étaient
en bois, de sorte qu’elles ont naturellement disparu sans laisser de traces (4)
; mais ce qui est vrai, c’est qu’un tel changement dans le mode de construction
correspond nécessairement à une modification profonde des conditions générales
d’existence du peuple chez qui il s’est produit.
En nous
rapprochant de l’Occident, nous voyons que la même époque fut, chez les Juifs,
celle de la captivité de Babylone ; et ce qui est peut-être un des faits les
plus étonnants qu’on ait à constater, c’est qu’une courte période de
soixante-dix ans fut suffisante pour leur faire perdre jusqu’à leur écriture,
puisqu’ils durent ensuite reconstituer les Livres sacrés avec des caractères
tout autres que ceux qui avaient été en usage jusqu’alors.
On pourrait
citer encore bien d’autres événements se rapportant à peu près à la même date :
nous noterons seulement que ce fut pour Rome le commencement de la période
proprement « historique », succédant à l’époque « légendaire » des rois, et
qu’on sait aussi, quoique d’une façon un peu vague, qu’il y eut alors
d’importants mouvements chez les peuples celtiques ; mais, sans y insister
davantage, nous en arriverons à ce qui concerne la Grèce.
2 Il faut
remarquer que le nom de Zoroastre désigne en réalité, non un personnage
particulier, mais une fonction, à la fois prophétique et législatrice ; il y
eut plusieurs Zoroastres, qui vécurent à des époques fort différentes ; et il
est même vraisemblable que cette fonction dut avoir un caractère collectif, de
même que celle de Vyâsa dans l’Inde, et de même aussi que, en Égypte, ce qui
fut attribué à Thoth ou Hermès représente l’œuvre de toute la caste
sacerdotale.
3 La question du
Bouddhisme est, en réalité, loin d’être aussi simple que pourrait le donner à
penser ce bref aperçu ; et il est intéressant de noter que, si les Hindous, au
point de vue de leur propre tradition, ont toujours condamné les Bouddhistes,
beaucoup d’entre eux n’en professent pas moins un grand respect pour le Bouddha
lui-même, quelques-uns allant même jusqu’à voir en lui le neuvième Avatâra, tandis
que d’autres identifient celui-ci avec le Christ. D’autre part, en ce qui
concerne le Bouddhisme tel qu’il est connu aujourd’hui, il faut avoir bien soin
de distinguer entre ses deux formes du Mahâyâna et du Hînayâna, ou du « Grand
Véhicule » et du « Petit Véhicule » ; d’une façon générale, on peut dire que le
Bouddhisme hors de l’Inde diffère notablement de sa forme indienne originelle,
qui commença à perdre rapidement du terrain après la mort d’Ashoka et disparut
complètement quelques siècles plus tard.
4 Ce cas n’est
pas particulier à l’Inde et se rencontre aussi en Occident ; c’est exactement
pour la même raison qu’on ne trouve aucun vestige des cités gauloises, dont
l’existence est cependant incontestable, étant attestée par des témoignages
contemporains ; et, là également, les historiens modernes ont profité de cette
absence de monuments pour dépeindre les Gaulois comme des sauvages vivant dans
les forêts.
Là
également, le VIe siècle fut le point de départ de la civilisation dite «
classique », la seule à laquelle les modernes reconnaissent le caractère «
historique », et tout ce qui précède est assez mal connu pour être traité de «
légendaire », bien que les découvertes archéologiques récentes ne permettent
plus de douter que, du moins, il y eut là une civilisation très réelle ; et
nous avons quelques raisons de penser que cette première civilisation
hellénique fut beaucoup plus intéressante intellectuellement que celle qui la
suivit, et que leurs rapports ne sont pas sans offrir quelque analogie avec
ceux qui existent entre l’Europe du moyen âge et l’Europe moderne.
Cependant,
il convient de remarquer que la scission ne fut pas aussi radicale que dans ce
dernier cas, car il y eut, au moins partiellement, une réadaptation effectuée
dans l’ordre traditionnel, principalement dans le domaine des « mystères » ; et
il faut y rattacher le Pythagorisme, qui fut surtout, sous une forme nouvelle,
une restauration de l’Orphisme antérieur, et dont les liens évidents avec le
culte delphique de l’Apollon hyperboréen permettent même d’envisager une
filiation continue et régulière avec l’une des plus anciennes traditions de
l’humanité. Mais, d’autre part, on vit bientôt apparaître quelque chose dont on
n’avait encore eu aucun exemple, et qui devait, par la suite, exercer une
influence néfaste sur tout le monde occidental : nous voulons parler de ce mode
spécial de pensée qui prit et garda le nom de « philosophie » ; et ce point est
assez important pour que nous nous y arrêtions quelques instants.
Le mot « philosophie », en lui-même, peut assurément être
pris en un sens fort légitime, qui fut sans doute son sens primitif, surtout
s’il est vrai que, comme on le prétend, c’est Pythagore qui l’employa le
premier : étymologiquement, il ne signifie rien d’autre qu’« amour de la
sagesse » ; il désigne donc tout d’abord une disposition préalable requise pour
parvenir à la sagesse, et il peut désigner aussi, par une extension toute
naturelle, la recherche qui, naissant de cette disposition même, doit conduire
à la connaissance.
Ce n’est
donc qu’un stade préliminaire et préparatoire, un acheminement vers la sagesse,
un degré correspondant à un état inférieur à celle-ci (5) ; la déviation qui
s’est produite ensuite a consisté à prendre ce degré transitoire pour le but
même, à prétendre substituer la « philosophie » à la sagesse, ce qui implique
l’oubli ou la méconnaissance de la véritable nature de cette dernière.
C’est ainsi
que prit naissance ce que nous pouvons appeler la philosophie « profane »,
c’est-à-dire une prétendue sagesse purement humaine, donc d’ordre simplement
rationnel, prenant la place de la vraie sagesse traditionnelle,
supra-rationnelle et « nonhumaine ». Pourtant, il subsista encore quelque chose
de celle-ci à travers toute l’antiquité ; ce qui le prouve, c’est d’abord la
persistance des « mystères », dont le caractère essentiellement « initiatique »
ne saurait être contesté, et c’est aussi le fait que l’enseignement des
philosophes eux-mêmes avait à la fois, le plus souvent, un côté « exotérique »
et un côté « ésotérique », ce dernier pouvant permettre le rattachement à un
point de vue supérieur, qui se manifeste d’ailleurs d’une façon très nette,
quoique peut-être incomplète à certains égards, quelques siècles plus tard,
chez les Alexandrins.
5 Le rapport est
ici à peu près le même que celui qui existe, dans la doctrine taoïste, entre
l’état de l’« homme doué » et celui de l’« homme transcendant ».
Pour que la
philosophie « profane » fût définitivement constituée comme telle, il fallait
que l’« exotérisme » seul demeurât et qu’on allât jusqu’à la négation pure et
simple de tout « ésotérisme » ; c’est précisément à quoi devait
aboutir,
chez les modernes, le mouvement commencé par les Grecs ; les tendances qui
s’étaient déjà affirmées chez ceux-ci devaient être alors poussées jusqu’à
leurs conséquences les plus extrêmes, et l’importance excessive qu’ils avaient
accordée à la pensée rationnelle allait s’accentuer encore pour en arriver au «
rationalisme », attitude spécialement moderne qui consiste, non plus même
simplement à ignorer, mais à nier expressément tout ce qui est d’ordre
supra-rationnel ; mais n’anticipons pas davantage, car nous aurons à revenir
sur ces conséquences et à en voir le développement dans une autre partie de
notre exposé.
Dans ce qui
vient d’être dit, une chose est à retenir particulièrement au point de vue qui
nous occupe : c’est qu’il convient de chercher dans l’antiquité « classique »
quelques-unes des origines du monde moderne ; celui-ci n’a donc pas entièrement
tort quand il se recommande de la civilisation gréco-latine et s’en prétend le
continuateur. Il faut dire, cependant, qu’il ne s’agit que d’une continuation
lointaine et quelque peu infidèle, car il y avait malgré tout, dans cette
antiquité, bien des choses, dans l’ordre intellectuel et spirituel, dont on ne
saurait trouver l’équivalent chez les modernes ; ce sont, en tout cas, dans
l’obscuration progressive de la vraie connaissance, deux degrés assez
différents.
On pourrait
d’ailleurs concevoir que la décadence de la civilisation antique ait amené,
d’une façon graduelle et sans solution de continuité, un état plus ou moins
semblable à celui que nous voyons aujourd’hui ; mais, en fait, il n’en fut pas
ainsi, et, dans l’intervalle, il y eut, pour l’Occident, une autre époque
critique qui fut en même temps une de ces époques de redressement auxquelles
nous faisions allusion plus haut.
Cette époque
est celle du début et de l’expansion du Christianisme, coïncidant, d’une part,
avec la dispersion du peuple juif, et, d’autre part, avec la dernière phase de
la civilisation gréco-latine ; et nous pouvons passer plus rapidement sur ces
événements, en dépit de leur importance, parce qu’ils sont plus généralement
connus que ceux dont nous avons parlé jusqu’ici, et que leur synchronisme a été
plus remarqué, même des historiens dont les vues sont les plus superficielles.
On a aussi
signalé assez souvent certains traits communs à la décadence antique et à
l’époque actuelle ; et, sans vouloir pousser trop loin le parallélisme, on doit
reconnaître qu’il y a en effet quelques ressemblances assez frappantes. La
philosophie purement « profane » avait gagné du terrain : l’apparition du
scepticisme d’un côté, le succès du « moralisme » stoïcien et épicurien de
l’autre, montrent assez à quel point l’intellectualité s’était abaissée. En
même temps, les anciennes doctrines sacrées, que presque personne ne comprenait
plus, avaient dégénéré, du fait de cette incompréhension, en « paganisme » au
vrai sens de ce mot, c’est-à-dire qu’elles n’étaient plus que des «
superstitions », des choses qui, ayant perdu leur signification profonde, se
survivent à elles-mêmes par des manifestations tout extérieures.
Il y eut des
essais de réaction contre cette déchéance : l’hellénisme lui-même tenta de se
revivifier à l’aide d’éléments empruntés aux doctrines orientales avec
lesquelles il pouvait se trouver en contact ; mais cela n’était plus suffisant,
la civilisation gréco-latine devait prendre fin, et le redressement devait
venir d’ailleurs et s’opérer sous une tout autre forme.
Ce fut le
Christianisme qui accomplit cette transformation ; et, notons-le en passant, la
comparaison qu’on peut établir sous certains rapports entre ce temps et le
nôtre est peut-être un des éléments déterminants du « messianisme » désordonné
qui se fait jour actuellement.
Après la
période troublée des invasions barbares, nécessaire pour achever la destruction
de l’ancien état de choses, un ordre normal fut restauré pour une durée de
quelques siècles ; ce fut le moyen âge, si méconnu des modernes qui sont
incapables d’en comprendre l’intellectualité, et pour qui cette époque paraît
certainement beaucoup plus étrangère et lointaine que l’antiquité « classique ».
Le vrai
moyen âge, pour nous, s’étend du règne de Charlemagne au début du XIVe siècle ;
à cette dernière date commence une nouvelle décadence qui, à travers des étapes
diverses, ira en s’accentuant jusqu’à nous.
C’est là
qu’est le véritable point de départ de la crise moderne : c’est le commencement
de la désagrégation de la « Chrétienté », à laquelle s’identifiait
essentiellement la civilisation occidentale du moyen âge ; c’est, en même temps
que la fin du régime féodal, assez étroitement solidaire de cette même «
Chrétienté », l’origine de la constitution des « nationalités ». Il faut donc
faire remonter l’époque moderne près de deux siècles plus tôt qu’on ne le fait
d’ordinaire ; la Renaissance et la Réforme sont surtout des résultantes, et
elles n’ont été rendues possibles que par la décadence préalable ; mais, bien
loin d’être un redressement, elles marquèrent une chute beaucoup plus profonde,
parce qu’elles consommèrent la rupture définitive avec l’esprit traditionnel,
l’une dans le domaine des sciences et des arts, l’autre dans le domaine
religieux lui-même, qui était pourtant celui où une telle rupture eût pu
sembler le plus difficilement concevable.
Ce qu’on
appelle la Renaissance fut en réalité, comme nous l’avons déjà dit en d’autres
occasions, la mort de beaucoup de choses ; sous prétexte de revenir à la
civilisation gréco-romaine, on n’en prit que ce qu’elle avait eu de plus
extérieur, parce que cela seul avait pu s’exprimer clairement dans des textes
écrits ; et cette restitution incomplète ne pouvait d’ailleurs avoir qu’un
caractère fort artificiel, puisqu’il s’agissait de formes qui, depuis des
siècles, avaient cessé de vivre de leur vie véritable. Quant aux sciences
traditionnelles du moyen âge, après avoir eu encore quelques dernières
manifestations vers cette époque, elles disparurent aussi totalement que celles
des civilisations lointaines qui furent jadis anéanties par quelque cataclysme
; et, cette fois, rien ne devait venir les remplacer. Il n’y eut plus désormais
que la philosophie et la science « profanes », c’est-à-dire la négation de la
véritable intellectualité, la limitation de la connaissance à l’ordre le plus
inférieur, l’étude empirique et analytique de faits qui ne sont rattachés à
aucun principe, la dispersion dans une multitude indéfinie de détails
insignifiants, l’accumulation d’hypothèses sans fondement, qui se détruisent
incessamment les unes les autres, et de vues fragmentaires qui ne peuvent
conduire à rien, sauf à ces applications pratiques qui constituent la seule
supériorité effective de la civilisation moderne ; supériorité peu enviable
d’ailleurs, et qui, en se développant jusqu’à étouffer toute autre
préoccupation, a donné à cette civilisation le caractère purement matériel qui
en fait une véritable monstruosité.
Ce qui est
tout à fait extraordinaire, c’est la rapidité avec laquelle la civilisation du
moyen âge tomba dans le plus complet oubli ; les hommes du XVIIe siècle n’en
avaient plus la moindre notion, et les monuments qui en subsistaient ne
représentaient plus rien à leurs yeux, ni dans l’ordre intellectuel, ni même
dans l’ordre esthétique ; on peut juger
par là combien la mentalité avait été changée dans l’intervalle.
Nous
n’entreprendrons pas de rechercher ici les facteurs, certainement fort
complexes, qui concoururent à ce changement, si radical qu’il semble difficile
d’admettre qu’il ait pu s’opérer spontanément et sans l’intervention d’une
volonté directrice dont la nature exacte demeure forcément assez énigmatique ;
il y a, à cet égard, des circonstances bien étranges, comme la vulgarisation, à
un moment déterminé, et en les présentant comme des découvertes nouvelles, de
choses qui étaient connues en réalité depuis fort longtemps, mais dont la
connaissance, en raison de certains inconvénients qui risquaient d’en dépasser
les avantages, n’avait pas été répandue jusque là dans le domaine public (6).
Il est bien
invraisemblable aussi que la légende qui fit du moyen âge une époque de «
ténèbres », d’ignorance et de barbarie, ait pris naissance et se soit
accréditée d’elle-même, et que la véritable falsification de l’histoire à
laquelle les modernes se sont livrés ait été entreprise sans aucune idée
préconçue ; mais nous n’irons pas plus avant dans l’examen de cette question,
car, de quelque façon que ce travail se soit accompli, c’est, pour le moment, la
constatation du résultat qui, en somme, nous importe le plus.
Il y a un
mot qui fut mis en honneur à la Renaissance, et qui résumait par avance tout le
programme de la civilisation moderne : ce mot est celui d’« humanisme ». Il
s’agissait en effet de tout réduire à des proportions purement humaines, de
faire abstraction de tout principe d’ordre supérieur, et, pourrait-on dire
symboliquement, de se détourner du ciel sous prétexte de conquérir la terre ;
les Grecs, dont on prétendait suivre l’exemple, n’avaient jamais été aussi loin
en ce sens, même au temps de leur plus grande décadence intellectuelle, et du
moins les préoccupations utilitaires n’étaient-elles jamais passées chez eux au
premier plan, ainsi que cela devait bientôt se produire chez les modernes.
L’«
humanisme », c’était déjà une première forme de ce qui est devenu le « laïcisme
» contemporain ; et, en voulant tout ramener à la mesure de l’homme, pris pour
une fin en lui-même, on a fini par descendre, d’étape en étape, au niveau de ce
qu’il y a en celui-ci de plus inférieur, et par ne plus guère chercher que la
satisfaction des besoins inhérents au côté matériel de sa nature, recherche
bien illusoire, du reste, car elle crée toujours plus de besoins artificiels
qu’elle n’en peut satisfaire.
Le monde
moderne ira-t-il jusqu’au bas de cette pente fatale, ou bien, comme il est
arrivé à la décadence du monde gréco-latin, un nouveau redressement se produira
t’il, cette fois encore, avant qu’il n’ait atteint le fond de l’abîme où il est
entraîné ? Il semble bien qu’un arrêt à mi-chemin ne soit plus guère possible,
et que, d’après toutes les indications fournies par les doctrines
traditionnelles, nous soyons entrés vraiment dans la phase finale du Kali-Yuga,
dans la période la plus sombre de cet « âge sombre », dans cet état de
dissolution dont il n’est plus possible de sortir que par un cataclysme, car ce
n’est plus un simple redressement qui est alors nécessaire, mais une rénovation
totale.
6 Nous ne
citerons que deux exemples, parmi les faits de ce genre qui devaient avoir les
plus graves conséquences : la prétendue invention de l’imprimerie, que les
Chinois connaissaient antérieurement à l’ère chrétienne, et la découverte «
officielle » de l’Amérique, avec laquelle des communications beaucoup plus
suivies qu’on ne le pense avaient existé durant tout le moyen âge.
Le désordre
et la confusion règnent dans tous les domaines ; ils ont été portés à un point
qui dépasse de loin tout ce qu’on avait vu précédemment, et, partis de
l’Occident, ils menacent maintenant d’envahir le monde tout entier ; nous
savons bien que leur triomphe ne peut jamais être qu’apparent et passager,
mais, à un tel degré, il paraît être le signe de la plus grave de toutes les
crises que l’humanité ait traversées au cours de son cycle actuel.
Ne
sommes-nous pas arrivés à cette époque redoutable annoncée par les Livres
sacrés de l’Inde, « où les castes seront mêlées, où la famille même n’existera
plus » ?
Il suffit de
regarder autour de soi pour se convaincre que cet état est bien réellement
celui du monde actuel, et pour constater partout cette déchéance profonde que
l’Évangile appelle « l’abomination de la désolation ». Il ne faut pas se
dissimuler la gravité de la situation ; il convient de l’envisager telle
qu’elle est, sans aucun « optimisme », mais aussi sans aucun « pessimisme »,
puisque, comme nous le disions précédemment, la fin de l’ancien monde sera
aussi le commencement d’un monde nouveau.
Maintenant, une question se pose : quelle est la raison
d’être d’une période comme celle où nous vivons ?
En effet, si anormales que soient les conditions présentes
considérées en elles-mêmes, elles doivent cependant rentrer dans l’ordre
général des choses, dans cet ordre qui, suivant une formule extrême-orientale,
est fait de la somme de tous les désordres ; cette époque, si pénible et si
troublée qu’elle soit, doit avoir aussi, comme toutes les autres, sa place
marquée dans l’ensemble du développement humain, et d’ailleurs le fait même
qu’elle était prévue par les doctrines traditionnelles est à cet égard une
indication suffisante.
Ce que nous avons dit de la marche générale d’un cycle de
manifestation, allant dans le sens d’une matérialisation progressive, donne
immédiatement l’explication d’un tel état, et montre bien que ce qui est
anormal et désordonné à un certain point de vue particulier n’est pourtant que
la conséquence d’une loi se rapportant à un point de vue supérieur ou plus
étendu.
Nous ajouterons, sans y insister, que, comme tout changement
d’état, le passage d’un cycle à un autre ne peut s’accomplir que dans
l’obscurité ; il y a là encore une loi fort importante et dont les applications
sont multiples, mais dont, par cela même, un exposé quelque peu détaillé nous
entraînerait beaucoup trop loin (7).
Ce n’est pas tout : l’époque moderne doit nécessairement
correspondre au développement de certaines des possibilités qui, dès l’origine,
étaient incluses dans la potentialité du cycle actuel ; et, si inférieur que
soit le rang occupé par ces possibilités dans la hiérarchie de l’ensemble, elles
n’en devaient pas moins, aussi bien que les autres, être appelées à la
manifestation selon l’ordre qui leur était assigné. Sous ce rapport, ce qui,
suivant la tradition, caractérise l’ultime phase du cycle, c’est, pourrait-on
dire, l’exploitation de tout ce qui a été négligé ou rejeté au cours des phases
précédentes ; et, effectivement, c’est bien là ce que nous pouvons constater
dans la civilisation moderne, qui ne vit en quelque sorte que de ce dont les civilisations
antérieures n’avaient pas voulu.
7 Cette loi était représentée, dans les mystères
d’Éleusis, par le symbolisme du grain de blé ; les alchimistes la figuraient
par la « putréfaction » et par la couleur noire qui marque le début du « Grand
Œuvre » ; ce que les mystiques chrétiens appellent la « nuit obscure de l’âme »
n’en est que l’application au développement spirituel de l’être qui s’élève à
des états supérieurs ; et il serait facile de signaler encore bien d’autres
concordances.
Il n’y a, pour s’en rendre compte, qu’à voir comment les représentants de celles de ces civilisations qui se sont maintenues jusqu’ici dans le monde oriental apprécient les sciences occidentales et leurs applications industrielles.
Ces connaissances inférieures, si vaines au regard de qui
possède une connaissance d’un autre ordre, devaient pourtant être « réalisées
», et elles ne pouvaient l’être qu’à un stade où la véritable intellectualité
aurait disparu ; ces recherches d’une portée exclusivement pratique, au sens le
plus étroit de ce mot, devaient être accomplies, mais elles ne pouvaient l’être
qu’à l’extrême opposé de la spiritualité primordiale, par des hommes enfoncés
dans la matière au point de ne plus rien concevoir au delà, et devenant
d’autant plus esclaves de cette matière qu’ils voudraient s’en servir
davantage, ce qui les conduit à une agitation toujours croissante, sans règle
et sans but, à la dispersion dans la pure multiplicité, jusqu’à la dissolution
finale.
Telle est, esquissée dans ses grands traits et réduite à
l’essentiel, la véritable explication du monde moderne ; mais, déclarons-le
très nettement, cette explication ne saurait aucunement être prise pour une
justification. Un malheur inévitable n’en est pas moins un malheur ; et, même
si du mal doit sortir un bien, cela n’enlève point au mal son caractère ; nous
n’employons d’ailleurs ici, bien entendu, ces termes de « bien » et de « mal »
que pour nous faire mieux comprendre, et en dehors de toute intention
spécifiquement « morale ». Les désordres partiels ne peuvent pas ne pas être,
parce qu’ils sont des éléments nécessaires de l’ordre total ; mais, malgré
cela, une époque de désordre est, en elle-même, quelque chose de comparable à
une monstruosité, qui, tout en étant la conséquence de certaines lois
naturelles, n’en est pas moins une déviation et une sorte d’erreur, ou à un
cataclysme, qui, bien que résultant du cours normal des choses, est tout de
même, si on l’envisage isolément, un bouleversement et une anomalie.
La civilisation moderne, comme toutes choses, a forcément sa
raison d’être, et, si elle est vraiment celle qui termine un cycle, on peut
dire qu’elle est ce qu’elle doit être, qu’elle vient en son temps et en son
lieu ; mais elle n’en devra pas moins être jugée selon la parole évangélique
trop souvent mal comprise : « Il faut qu’il y ait du scandale ; mais malheur à
celui par qui le scandale arrive ! »
A suivre : CHAPITRE II – L’opposition de l’Orient et de l’Occident
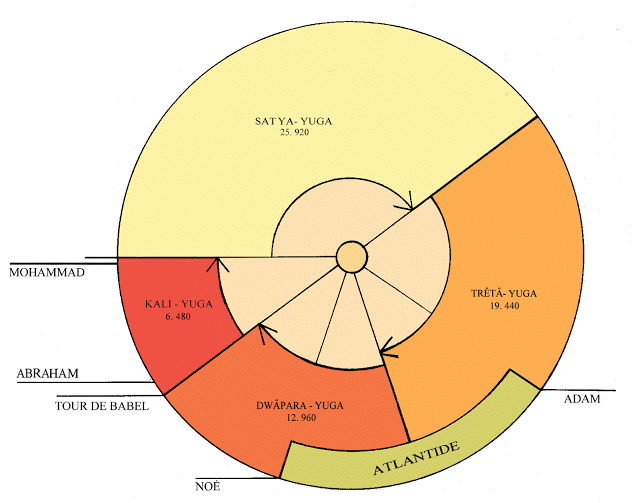

@Leigia
RépondreSupprimerOn a bien compris qu'il y a un grand Cycle appelé Manvantara, lui même comportant des des âges.
J'ai entendu un jour Rorschach dire que ce même Manvantara serait précédé par un autre grand cycle (appelé Kalpas).
Aurais-tu une documentation dans ce sens ?
Merci
Pas tout à fait ce que Ror a expliqué il me semble. Un Kalpa c'est le développement total d’un monde ; il contient 14 Manvantaras qui sont eux-mêmes composés des 4 âges... :-)
SupprimerLa doctrine des cycles a été exposée par René Guénon ; tu as lu ces deux textes en préambule ? Tu y verras que lorsque tu me parlais du "pôle nord" tu ne croyais pas si bien dire ! ^ ^
https://lapieceestjouee.blogspot.com/2018/05/atlantide-et-hyperboree.html
https://lapieceestjouee.blogspot.com/2018/05/place-de-la-tradition-atlanteenne-dans.html
Je vais mettre un dernier article sur les cycles mais il est un peu plus ardu alors j'y ajouterai un schéma perso sur lequel je travaille... Encore qques jours de patience je ne veux pas bâcler ! ^ ^
Ah d'accord, j'avais mal compris.
SupprimerMerci Leigia pour cette correction.
Je vais lire tes deux autres articles :)
Bon courage pour le nouvel article ;)