Cette série est issue du livre de René Guénon - ORIENT et OCCIDENT et se rapporte à la partie II : "Les possibilités de rapprochement".
Le livre en pdf :
Cette série se composera comme suit :
CHAPITRE I - TENTATIVES INFRUCTUEUSES
CHAPITRE II - L’ACCORD SUR LES PRINCIPES
CHAPITRE III - CONSTITUTION ET RÔLE DE
L’ELITE
CHAPITRE IV - ENTENTE ET NON FUSION
CONCLUSION
CHAPITRE PREMIER : TENTATIVES INFRUCTUEUSES
Partie 1
En formulant l’idée d’un rapprochement entre l’Orient et l’Occident,
nous n’avons point la prétention d’émettre une idée nouvelle, ce qui,
d’ailleurs, n’est nullement nécessaire pour qu’elle soit intéressante ; l’amour
de la nouveauté, qui n’est pas autre chose que le besoin de changement, et la
recherche de l’originalité, conséquence d’un individualisme intellectuel qui
confine à l’anarchie, ce sont là des caractères propres à la mentalité moderne
et par lesquels s’affirment les tendances anti traditionnelles.
En fait, cette idée de rapprochement a pu venir déjà à l’esprit de
bien des gens en Occident, ce qui ne lui enlève rien de sa valeur ni de son
importance ; mais nous devons constater qu’elle n’a produit jusqu’ici aucun
résultat, que l’opposition n’a même fait qu’aller en s’accentuant toujours, ce
qui était inévitable dès lors que l’Occident continuait à suivre sa ligne
divergente. C’est à l’Occident seul, en effet, que doit être imputé cet
éloignement, puisque l’Orient n’a jamais varié quant à l’essentiel ; et toutes
les tentatives qui ne tenaient pas compte de ce fait devaient forcément
échouer.
Le grand défaut de ces tentatives, c’est qu’elles ont toujours été
faites en sens inverse de ce qu’il aurait fallu pour réussir : c’est à
l’Occident de se rapprocher de l’Orient, puisque c’est lui qui s’en est
éloigné, et c’est en vain qu’il s’efforcera de persuader à l’Orient de se
rapprocher de lui, car l’Orient estime n’avoir pas plus de raisons de changer
aujourd’hui qu’au cours des siècles précédents. Bien entendu, il ne s’est
jamais agi, pour les Orientaux, d’exclure les adaptations qui sont compatibles
avec le maintien de l’esprit traditionnel, mais, si l’on vient leur proposer un
changement qui équivaut à une subversion de tout l’ordre établi, ils ne peuvent
qu’y opposer une fin de non-recevoir ; et le spectacle que leur offre
l’Occident est bien loin de les engager à se laisser convaincre. Même si les
Orientaux se trouvent contraints d’accepter dans une certaine mesure le progrès
matériel, cela ne constituera jamais pour eux un changement profond, parce que,
comme nous l’avons déjà dit, ils ne s’y intéresseront pas ; ils le subiront
simplement comme une nécessité, et ils n’y trouveront qu’un motif
supplémentaire de ressentiment contre ceux qui les auront obligés à s’y
soumettre ; loin de renoncer à ce qui est pour eux toute leur raison d’être.
Ils le renfermeront en eux-mêmes plus strictement que jamais, et ils se feront
encore plus distants et plus inaccessibles.
D’ailleurs, la civilisation occidentale étant de beaucoup la plus
jeune de toutes, les règles de la plus élémentaire politesse, si elles étaient
de mise dans les relations des peuples ou des races comme dans celles des
individus, devraient suffire pour lui montrer que c’est à elle, et non aux
autres qui sont ses aînées, qu’il appartient de faire les premiers pas.
Certes, c’est bien l’Occident qui est allé trouver les Orientaux, mais
avec des intentions toutes contraires : non pour s’instruire auprès d’eux,
comme il sied aux jeunes gens qui se rencontrent avec des vieillards, mais pour
s’efforcer, tantôt brutalement, tantôt insidieusement, de les convertir à sa
propre manière de voir, pour leur prêcher toutes sortes de choses dont ils
n’ont que faire ou dont ils ne veulent pas entendre parler. Les Orientaux, qui
tous apprécient fort la politesse, sont choqués de ce prosélytisme intempestif
comme d’une grossièreté ; venant s’exercer dans leur propre pays, il constitue
même, ce qui est encore plus grave à leurs yeux, un manquement aux lois de
l’hospitalité ; et la politesse orientale, qu’on ne s’y trompe pas, n’est point
un vain formalisme comme l’observation des coutumes tout extérieures auxquelles
les Occidentaux donnent le même nom : elle repose sur des raisons autrement
profondes, parce qu’elle tient à tout l’ensemble d’une civilisation
traditionnelle, tandis que, en Occident, ces raisons ayant disparu avec la
tradition, ce qui subsiste n’est plus que superstition à proprement parler,
sans compter les innovations dues tout simplement à la « mode » et à ses
caprices injustifiables, et avec lesquelles on tombe dans la parodie.
Mais, pour en revenir au prosélytisme, il n’est pour les Orientaux,
toute question de politesse à part, qu’une preuve d’ignorance et
d’incompréhension, le signe d’un défaut d’intellectualité, parce qu’il implique
et suppose essentiellement la prédominance du sentimentalisme : on ne peut
faire de propagande pour une idée que si l’on y attache un intérêt sentimental
quelconque, au détriment de sa pureté ; pour ce qui est des idées pures, on se
contente de les exposer pour ceux qui sont capables de les comprendre, sans
jamais se préoccuper d’entraîner la conviction de qui que ce soit. Ce jugement
défavorable auquel donne prise le prosélytisme, tout ce que disent et font les
Occidentaux est pour le confirmer ; tout ce par quoi ils croient prouver leur
supériorité, ce ne sont pour les Orientaux qu’autant de marques d’infériorité.
Si l’on se place en dehors de tout préjugé, il faut bien se résigner à
admettre que l’Occident n’a rien à enseigner à l’Orient, si ce n’est dans le
domaine purement matériel, auquel l’Orient, encore une fois, ne peut pas
s’intéresser, parce qu’il a à sa disposition des choses auprès desquelles
celles-là ne comptent guère, et qu’il n’est pas disposé à sacrifier pour de
vaines et futiles contingences. Du reste, le développement industriel et
économique, comme nous l’avons déjà dit, ne peut provoquer que la concurrence
et la lutte entre les peuples ; ce ne saurait donc être un terrain de
rapprochement, à moins qu’on ne prétende que c’est encore une manière de
rapprocher les hommes que de les amener à se battre les uns contre les autres ;
mais ce n’est pas ainsi que nous l’entendons, et ce ne serait là en somme qu’un
fort mauvais jeu de mots.
Pour nous, quand nous parlons de rapprochement, il s’agit d’entente et
non de concurrence ; d’ailleurs, la seule façon dont certains Orientaux peuvent
être tentés d’admettre chez eux le développement économique, ainsi que nous
l’avons expliqué, ne laisse de ce côté aucun espoir. Ce ne sont pas les
facilités apportées par les inventions mécaniques aux relations extérieures
entre les peuples qui donneront jamais à ceux-ci les moyens de mieux se
comprendre ; il ne peut en résulter, et cela d’une façon tout à fait générale,
que des heurts plus fréquents et des conflits plus étendus ; quant aux accords
basés sur des intérêts purement commerciaux, on ne devrait savoir que trop
quelle valeur il convient de leur attribuer.
La matière est, de sa nature, un principe de division et de séparation
; tout ce qui en procède ne saurait servir à fonder une union réelle et
durable, et d’ailleurs c’est le changement incessant qui est ici la loi. Nous
ne voulons pas dire qu’il ne faille aucunement se préoccuper des intérêts
économiques ; mais, comme nous le répétons sans cesse, il faut mettre chaque
chose à sa place, et celle qui leur revient normalement serait plutôt la
dernière que la première. Ce n’est point à dire non plus qu’il faille y
substituer des utopies sentimentales à la manière d’une « société des nations »
quelconque ; cela est encore moins solide si c’est possible, n’ayant même pas
pour fondement cette réalité brutale et grossière qu’on ne peut du moins
contester aux choses de l’ordre purement sensible ; et le sentiment, en
lui-même, n’est pas moins variable et inconstant que ce qui appartient au
domaine proprement matériel.
Du reste, l’humanitarisme, avec toutes ses rêveries, n’est bien
souvent qu’un masque des intérêts matériels, masque imposé par l’hypocrisie «
moraliste » ; nous ne croyons guère au désintéressement des apôtres de la «
civilisation », et d’ailleurs, à vrai dire, le désintéressement n’est pas une
vertu politique. Au fond, ce n’est ni sur le terrain économique ni sur le
terrain politique que les moyens d’une entente pourront jamais être trouvés, et
ce n’est qu’après coup et secondairement que l’activité économique et politique
sera appelée à bénéficier de cette entente ; ces moyens, s’ils existent, ne
relèvent ni du domaine de la matière ni de celui du sentiment, mais d’un
domaine beaucoup plus profond et plus stable, qui ne peut être que celui de
l’intelligence. Seulement, nous voulons entendre ici l’intelligence au sens
vrai et complet ; il ne s’agit aucunement, dans notre pensée, de ces
contrefaçons d’intellectualité que l’Occident s’obstine malheureusement à
présenter à l’Orient, et qui sont d’ailleurs tout ce qu’il peut lui présenter,
puisqu’il ne connaît rien d’autre et que, même pour son propre usage, il n’a
pas autre chose à sa disposition ; mais ce qui suffit à contenter l’Occident
sous ce rapport est parfaitement impropre à donner à l’Orient la moindre
satisfaction intellectuelle, dès lors qu’il y manque tout l’essentiel.
La science occidentale, même pour autant qu’elle ne se confond pas
purement et simplement avec l’industrie et qu’elle est indépendante des
applications pratiques, n’est encore, aux yeux des Orientaux, que ce « savoir
ignorant » dont nous avons parlé, parce qu’elle ne se rattache à aucun principe
d’un ordre supérieur. Limitée au monde sensible qu’elle prend pour son unique
objet, elle n’a pas par elle-même une valeur proprement spéculative ; si encore
elle était un moyen préparatoire pour atteindre à une connaissance d’un ordre
plus élevé, les Orientaux seraient fort enclins à la respecter, tout en
estimant que ce moyen est bien détourné, et surtout qu’il est peu adapté à leur
propre mentalité ; mais il n’en est point ainsi.
Cette science, au contraire, est constituée de telle façon qu’elle
crée fatalement un état d’esprit aboutissant à la négation de toute autre
connaissance, ce que nous avons appelé le « scientisme » ; ou elle est prise
pour une fin en elle-même, ou elle n’a d’issue que du côté des applications
pratiques, c’est-à-dire dans l’ordre le plus inférieur, où le mot même de «
connaissance », avec la plénitude de sens qu’y attachent les Orientaux, ne
saurait plus être employé que par la plus abusive des extensions. Les résultats
théoriques de la science analytique, si considérables qu’ils paraissent aux
Occidentaux, ne sont que de bien petites choses pour les Orientaux, à qui tout
cela fait l’effet d’amusements enfantins, indignes de retenir longtemps
l’attention de ceux qui sont capables d’appliquer leur intelligence à d’autres
objets, autant dire de ceux qui possèdent la véritable intelligence, car le
reste n’en est qu’un reflet plus ou moins obscurci.
Voilà à quoi se réduit la « haute idée » que les Orientaux peuvent se
faire de la science européenne, au dire des Occidentaux (qu’on se rappelle ici
l’exemple de Leibnitz que nous avons cité plus haut), et cela même si on leur
en présente les productions les plus authentiques et les plus complètes, non
point seulement les rudiments de la « vulgarisation » ; et ce n’est point là,
de leur part, incapacité de la comprendre et de l’apprécier, mais c’est au
contraire parce qu’ils l’estiment à sa juste valeur, à l’aide d’un terme de
comparaison qui manque aux Occidentaux.
La science européenne, en effet, parce qu’elle n’a rien de profond,
parce qu’elle n’est véritablement rien de plus que ce qu’elle paraît, est
facilement accessible à quiconque veut prendre la peine de l’étudier ; sans
doute, toute science est spécialement appropriée à la mentalité du peuple qui
l’a produite, mais il n’y a pas là le moindre équivalent des difficultés que
rencontrent les Occidentaux qui veulent pénétrer les « sciences traditionnelles
» de l’Orient, difficultés qui proviennent de ce que ces sciences partent de
principes dont ils n’ont aucune idée, et de ce qu’elles emploient des moyens
d’investigation qui leur sont totalement étrangers, parce qu’ils dépassent les
cadres étroits où s’enferme l’esprit occidental.
Le défaut d’adaptation, s’il
existe des deux côtés, se traduit de façons bien différentes : pour les
Occidentaux qui étudient la science orientale, c’est une incompréhension à peu
près irrémédiable, quelle que soit l’application qu’ils y mettent, à part des
exceptions individuelles toujours possibles, mais très peu nombreuses ; pour
les Orientaux qui étudient la science occidentale, c’est seulement un manque
d’intérêt qui n’empêche point la compréhension, mais qui, évidemment, dispose
peu à consacrer à cette étude des forces qui peuvent être mieux employées.
Qu’on ne compte donc pas sur la propagande scientifique, non plus que sur
aucune espèce de propagande, pour arriver à un rapprochement avec l’Orient ;
l’importance même que les Occidentaux attribuent à ces choses donne aux
Orientaux une assez pauvre idée de leur mentalité, et, s’ils les regardent comme
intellectuelles, c’est que l’intellectualité n’a pas le même sens pour eux que
pour les Orientaux.
A suivre....



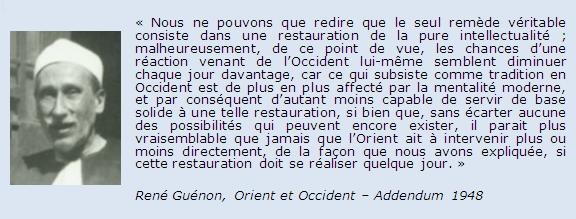

Aucun commentaire:
La publication de nouveaux commentaires n'est pas autorisée.